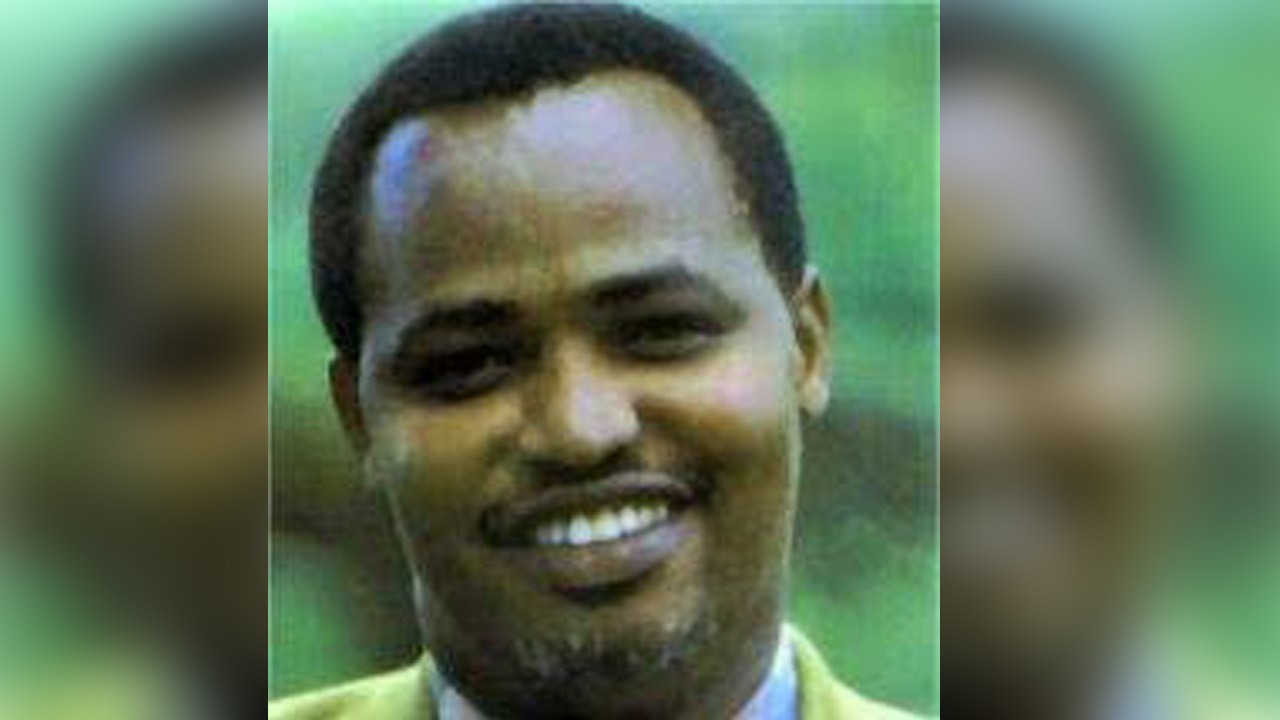La plupart des chrétiens seraient choqués de constater que les termes qu’ils emploient n’ont pas une genèse très réputée. Ils ont été inventés par les libéraux qui rejetaient certains éléments importants de la foi évangélique. Mais, par la grâce de Dieu, au fur du temps, avec la maturité, les évangéliques ont pu « convertir » ces concepts en patrimoine évangélique.
Sa prédication ne contenait pas du « Kerygma ». C’est une phrase que j’ai entendue d’un frère qui pourtant n’a aucun arrière-plan dans l’éducation théologique formelle. Il dénonçait par là l’homme sur la chaire qui avait tout fait sauf proclamer l’Evangile. Certains jargons ont su, avec le temps, sortir de l’académie pour devenir des expressions populaires.
Mais, la plupart des utilisateurs seraient choqués de constater que les termes qu’ils emploient n’ont pas une genèse très réputée. Ils ont été inventés par les libéraux qui rejetaient certains éléments importants de la foi évangélique. Mais, par la grâce de Dieu, au fur du temps, avec la maturité, les évangéliques ont pu « convertir » ces concepts en patrimoine évangélique important, ne retenant que le bon côté de la controverse.
Prenons par exemple Kerygma. A l’origine, cette expression très chère à un certain professeur allemand Rudolph Bultmann (1884-1976) voulait dire le contenu de la foi chrétienne après un processus de démythologisation. En fait, cet homme croyait que la Bible nous parle dans un vieux langage des mythes, qu’il ne faut pas croire littéralement tout ce qu’elle raconte, qu’il faut séparer les mythes des vérités qui en sont derrière.
Il rejetait non seulement les miracles de la Bible mais aussi certains faits historiques comme la résurrection de Jésus, car selon lui il faudra séparer le vrai Jésus des légendes que ses apôtres ont inventées pour véhiculer un certain enseignement concernant Jésus et il fallait extraire le vrai message de JÉSUS de tous ces mythes qui entourent sa personne.
Et c’était cela kerygma pour lui. Le terme vous plait toujours ? Les évangéliques l’ont finalement adopté pour désigner la prédication apostolique, ce message essentiel de l’Evangile, cette proclamation du Royaume de Dieu, révélé en Jésus Christ, un message qui englobe les grands faits salvateurs de l’incarnation, la mort, l’ensevelissement, la résurrection, l’ascension et le second avènement de Jésus, le Messager du Père par Excellence .
Notre temps
L’article d’aujourdui concerne un jargon qui a presque la même histoire : la théologie narrative. On va voir que bien que l’expression trouve ses origines dans les milieux théologiques libéraux du 19e siècle, les évangéliques peuvent en faire l’allié en tirant le maximum d’avantages, rejetant ses extrêmes et en tant qu’africains la théologie narrative pourrait enrichir énormément notre expérience ministérielle.
Origine de la théologie narrative
La théologie narrative est née principalement, bien que pas exclusivement, de l’école de Divinity de Yale dans la deuxième moitié du 20e siècle. Difficile de comprendre cette tendance sans commencer par la fin du 19è siècle avec le fondamentalisme et le libéralisme, contre lesquels la théologie narrative est réactionnaire.
La version courte des choses est que le mouvement rationaliste (entre 1650-1800) a eu tellement d’impact sur les institutions théologiques et a donné naissance à un certain libéralisme théologique promu par des penseurs soi-disant chrétiens mais qui rejetaient des choses fondamentales comme l’inspiration et l’inerrance des Ecritures, les miracles de la Bible, la véracité historique et la crédibilité scientifique de la Bible.
En réaction, des théologiens conservateurs, la plupart de Princeton, se sont ralliés contre cette tendance libérale. Des noms comme B.B Warfield, Darby, Billy Sunday, Dwight Moody unirent leurs forces pour combattre cette apostasie. Ils écrivirent 12 volumes pour défendre les fondements de la Foi chrétienne d’où le nom, les fondamentalistes.[1]
La théologie narrative peut être appelée post-libérale, dans le sens qu’elle ne se réclame d’aucun de ces deux camps. Elle est née au 20è siècle en tant que troisième alternative entre le libéralisme et le fondamentalisme. La vérité biblique, selon le post-libéralisme, prend simplement le récit comme modèle pour le discours et l’action théologiques, sans être liée aux présupposés ni de l’orthodoxie ni du libéralisme des Lumières. [2]
Dans un langage simple, on peut dire que la théologie narrative est basée sur l’idée que la théologie chrétienne doit utiliser la Bible comme une représentation narrative de la foi plutôt que de développer un ensemble de propositions fondées sur les Écritures elles-mêmes, comme ce qu’on appelle communément la « théologie systématique ». Pour faire bref, la théologie narrative a un sens assez large, mais il s’agit généralement d’une approche théologique qui cherche du sens au récit et rejette les propositions de vérité de la théologie systématique.
Les extrêmes de la théologie narrative
Le premier danger de la théologie narrative est flagrant à savoir le relativisme théologique. Cette façon de nier la vérité objective. D’ici provient l’animosité de cette mouvance envers la théologie systématique qui prétend faire des formulations dogmatiques absolues de la foi chrétienne. La version plus populaire de la théologie narrative peut être identifiée dans les églises émergentes. La prédication devient une pratique révolue car elle signifierait qu’une personne parle autoritairement aux autres, leur imposant ses vues. Les gens s’asseyent en cercle et discutent, échangent, comme chacun l’entend.
Un autre extrême réside dans un relativisme moral. La théologie narrative met un accent particulier sur le « ce qui importe c’est notre relation avec Dieu ». Si la Bible ne contient pas des vérités absolues à découvrir (relativisme théologique) elle ne contient pas non plus des règles morales à observer (relativisme moral). La Bible nous met en relation avec Dieu et c’est ce qui importe pour eux. Mais comment une telle relation peut-elle être vécue et entretenue dans un vide doctrinal?
Le bon côté de la théologie narrative
Avouons-le, la Bible raconte une histoire. Mais, nous avons malheureusement réduits la théologie en une série de propositions intellectuelles. La plupart des livres que nous lisons sont écrits en une prose académique et manque la belle dimension narrative de l’Histoire de Dieu.
Roger E. Olson, un théologien très réputé, essaie de sauver la théologie narrative de la fosse aux critiques et dit que « la théologie narrative reconnait que la Bible contient des propositions doctrinales mais ces propositions ne sont ni indépendantes ni supérieures à la grande histoire de l’œuvre rédemptrice de Dieu ». Il ajoute que « les propositions élucident l’Histoire de Dieu l’illustrent, la communiquent mieux et enfin de compte elles servent l’Histoire et non pas vice versa. »
Ce professeur de Baylor University continue et enfonce le clou en disant que « les doctrines sont secondaires à l’Histoire, elles ne peuvent pas la remplacer. Elles sont jugées par leur capacité à expliquer et exprimer fidèlement le caractère de Dieu révélé dans l’Histoire ».[3]
La théologie narrative, les théologies biblique et systématique et la relation avec Dieu
Ceci nous amène à la deuxième particularité de la théologie narrative : l’importance qu’elle accorde à la théologie biblique au-dessus de la théologie systématique. C’est l’une des grandes contributions de la théologie narrative. La méfiance de la théologie systématique est si avérée dans le mouvement émergent, une attitude en soi non recommandable et qui mène aux dérives du relativisme théologique.
Néanmoins, la théologie narrative utilisée de manière responsable nous fait découvrir la complémentarité entre la théologie systématique et la théologie biblique, et si j’ose dire la primauté même de cette dernière. Olson écrit que « La théologie biblique ne se soucie pas d’énoncer les doctrines finales qui constituent le contenu de la croyance chrétienne, mais plutôt de décrire le processus par lequel la révélation se déroule et se dirige vers le but qui est la révélation finale de Dieu de ses desseins en Jésus-Christ. La théologie biblique cherche à comprendre les relations entre les différentes époques de l’activité révélatrice de Dieu enregistrée dans la Bible.»
Et d’ajouter que « le théologien systématique s’intéresse principalement à l’article fini, l’énoncé de la doctrine chrétienne. Le théologien biblique, au contraire, s’intéresse plutôt au déploiement progressif de la vérité. C’est sur la base de la théologie biblique que le théologien systématique s’appuie sur les textes pré-Pentecôte de la Bible comme faisant partie du matériel à partir duquel la doctrine chrétienne peut être formulée.»[4]
La dernière contribution de la théologie narrative concerne son emphase sur notre relation avec Dieu. Classiquement, la tendance cartésienne qui domine les institutions théologiques a pour résultat le mépris d’une rencontre expérientielle avec Dieu, un mépris pour l’émotion et un dogmatisme orgueilleux.
Il est vrai que si notre soif de communier avec Dieu n’est pas basée et guidée par la Bible, elle risque de nous mener aux dérives d’un mysticisme non biblique. Néanmoins, la théologie narrative, par son emphase sur l’expérience personnelle avec Dieu nous rappelle que l’on n’est plus dans l’équilibre des choses que quand les précisions doctrinales priment sur notre relation avec Dieu. Connaissez-vous des cercles où la maturité chrétienne d’une personne est mesurée par sa capacité à articuler les doctrines que par la qualité de sa relation avec Dieu ?
La pertinence de la théologie narrative dans le contexte africain.
C’est un fait établi que la grande partie de la Bible est écrite dans une forme de récit. Mais la théologie narrative ne s’intéresse pas uniquement à ces parties narratives. Elle nous interpelle à lire TOUTE la Bible comme une Histoire Unifiée du Salut. Sur un continent comme le nôtre où le récit est le medium principal de communication des concepts et des principes, nous devrions nous sentir à l’aise avec la Bible plus que les occidentaux puisqu’elle a été écrite dans un contexte proche du nôtre, un contexte afro-asiatique.
Le problème est que nous sommes souvent conditionnés à lire et à interpréter la Bible en catégories purement cartésiennes. Le célèbre Craig Keener a épousé une congolaise et je crois qu’en plus de ses études spécialisées dans la Culture et l’Histoire comme arrières plan de la Bible, son mariage lui a permis de voir plus clair. Il dit, « La plupart des théologiens qui remettent en question l’utilisation des récits sont, par contraste, des Occidentaux ou des personnes formées à l’occidentale, des rejetons du Siècle des Lumières. En fait, certains Occidentaux pensent même que les histoires bibliques ne sont pas à la portée de tous. Même aux États-Unis, les églises noires se sont spécialisées, et ce, pendant des générations, dans la prédication narrative.»
Il ajoute que «dans la plupart des églises, les enfants grandissent en aimant les histoires bibliques jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes et que nous leur enseignions qu’ils doivent maintenant penser de façon abstraite plutôt que d’apprendre à partir d’illustrations concrètes. Ce n’est pas parce notre méthode traditionnelle d’extraction de la doctrine biblique ne fonctionne pas bien avec les récits que les histoires bibliques n’ont aucun message à communiquer. Au contraire, cela montre combien notre façon d’appliquer la méthode traditionnelle d’interprétation est inadéquate, et ce, parce que nous ignorons une grande partie de la Parole de Dieu. »[5]
Si nos prédicateurs sont formés à l’occidentale, cela se répercute sur leur approche au ministère et la prédication en particulier. Ils sont plus préoccupés à fournir une présentation logique et analytique au lieu de communiquer l’Histoire du Salut dans des catégories de pensée africaine. La fâcheuse conséquence est qu’ils se retrouvent déconnectés de l’audience. Ils sont déçus et finissent par accuser l’audience de son manque d’instruction alors que c’est eux qui ont besoin d’être plus instruits dans la prédication narrative.
Pourquoi les occidentaux sont en train de prendre conscience de cette lacune dans leur curriculum académique avant nous ,africains, qui devrions nous sentir plus concernés ? De nombreux prédicateurs évitent les histoires ou les traitent mal en raison … d’une mauvaise formation. Dans le passé, les prédicateurs avaient tendance à traiter les histoires comme des allégories ou des illustrations d’idées théologiques préconçues tirées de passages didactiques. Ces prédicateurs ne comprenaient pas la littérature narrative et n’ont pas appris à l’interpréter. Ce manque de formation continue jusqu’à présent. Les séminaires offrent rarement, voire jamais, les cours obligatoires d’exégèse et de prédication de récits. La plupart exigent des cours exégétiques axés sur du matériel didactique, qui ne forment pas les étudiants à comprendre et à communiquer la littérature narrative. Le plus souvent, les méthodologies qui nous permettent de comprendre la littérature didactique nous empêchent de comprendre la littérature narrative.
Le besoin de contextualisation
En nous inspirant de la richesse de notre culture, nos traditions et notre façon de penser et de communiquer, nous avons le devoir de trouver un modèle de prédication qui marche mieux dans notre contexte. Alors que je lis « Towards an african narrative theology » de deux prêtres occidentaux qui me font découvrir les richesses de la tradition orale africaine et comment s’en servir comme un outil contextuel dans la prédication, je me demande quand nous aurons des théologiens locaux qui auront retenu la leçon … que l’on doit faire de la théologie comme des africains, et que devenir un simple écho de nos professeurs et institutions théologiques est une perte fatale pour notre riche patrie. A bon entendeur salut !
[1]www.gotquestions.org/Francais/fondamentalisme.html visité le 17 Février
[2] https://www.thegospelcoalition.org/essay/narrative-theology/ visité le 15 Février
[3] https://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2016/01/narrative-theology-explained/visité le 15Fevrier 2022
[4] Ibid.
[5] Je recommande à quiconque qui lit cet article le livre Interprétation biblique, gratuitement téléchargeable ici :https://www.bing.com/search?pc=MUWN&form=Silk21&q=interpretation+biblique+par+Craig+Keener+free+pdf

NIKIZA Jean-Apôtre est un Pasteur qui exerce son ministère depuis la ville de Bujumbura. Il est marié à Arielle T. NIKIZA et ensemble, ils sont pionniers du Mouvement des Hédonistes Chrétiens, Sa Bannière depuis 2015. Ils sont aussi co-fondateurs de Little Flock Ministries. La spiritualité chrétienne et le Renouveau spirituel de l’Eglise restent les grandes marques de leur appel commun. Les moments de loisirs de NIKIZA J-A incluent les films, la musique,le Basketball et un bon sommeil.
CHOIX DE L'ÉDITEUR
L’adoration dans nos cultes
Si un mouvement ne chante pas, il meurt.
Le plus beau rêve ou le pire cauchemar ?
C’était en 2015, je venais de me réveiller en sursaut à trois heures du matin après un horrible rêve ! Je rêvais qu’un de mes êtres les plus chers était en procès et que la sentence était tombée … Il allait être exécuté.
Qui était David Ndaruhutse ?
Qui était David NDARUHUTSE? Quelles étaient ses origines ? Quelles ont été ses accomplissements durant sa courte durée dans le ministère ? Que sont devenus sa famille et son ministère ? Son Fils Peter NDARUHUTSE nous raconte.
La gloire de Dieu est mon trésor
Les saintes écritures nous exposent du début à la fin un Dieu, qui, dans Sa parfaite intelligence et selon le conseil de Sa parfaite volonté, bénit toute la création à partir de Sa gloire. Il a fait de sorte que toute joie réelle et durable passe par Sa gloire.
Quand lire la Bible devient une dure corvée
Soyons honnêtes, il nous est tous déjà arrivés de trouver la Bible ennuyeuse, au moins certaines de ses parties. Il nous est déjà arrivés de nous demander à quoi certains passages riment vraiment et pourquoi ont-ils été insérés dans un livre saint dont la lecture est sensée nous apporter tant d’excitation et de passion !