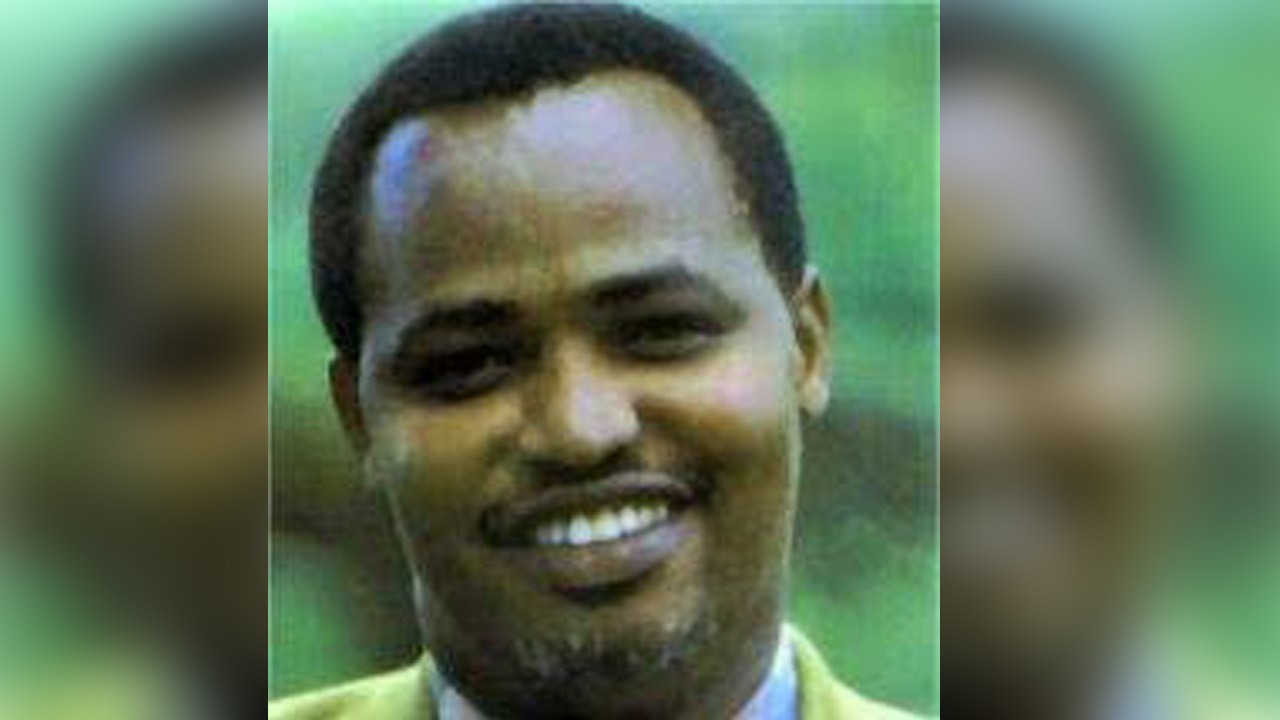Le président Bagaza s’acharna contre l’Église catholique, un conflit, qui par extension et indirectement va affecter les églises protestantes.
L’Histoire de l’Eglise du Burundi en cinq périodes
Il existe une grande lacune dans la connaissance de l'Histoire de l'Eglise du Burundi surtout parmi la jeune génération des chrétiens/serviteurs de Dieu. Cela ne va pas sans graves conséquences sur nos approches ministérielles en général mais plus en particulier sur le sens d’appartenir à un peuple de Dieu historique qui dans ses chutes et victoires et bassesses et gloires, faiblesses et forces, demeure le résultat d’une œuvre de grâce de Dieu dans les vies des gens imparfaits. Nous sommes le fruit de cette Eglise que Dieu est venu chercher à travers la première flamme de passion qu’il alluma dans le cœur du premier missionnaire. Nos ministères et églises sont le résultat des efforts infatigables et sacrificiels des hommes et femmes de Dieu que l’Histoire a facilement oublié mais qui comptent pour Dieu. Je regarde le passé de cette Eglise avec discernement mais aussi avec beaucoup d‘humilité. Je contemple son avenir avec réalisme mais aussi avec beaucoup de foi et espérance.
Dans cette série d’articles, en soi sommaires, nous allons parcourir son histoire en 5 périodes importantes :
Nous entamons la troisième partie de notre série qui parle de l’émergence des églises de réveil sous le règne de Buyoya. Mais avant cela les églises sont persécutées sous le règne de Bagaza.
Le colonel Bagaza, un président amphibologique
Il est jeune, intelligent et Il a juste 30 ans. On est le 1er Novembre 1976 et Bagaza devient le président de la deuxième république du Burundi. Mais que ce qui traverse son esprit en ce moment ? Des idées, il en a. Longtemps après, les burundais se souviendront de lui comme celui qui a essayé de relancer le développent économique du pays, tant négligé à la fois par son prédécesseur Micombero et son successeur Buyoya. Il réussira en partie dans ses regroupements de paysans, réformes agraires, développement des infrastructures économiques et sociales, viabilisation de la ville de Bujumbura. Et durant la décennie de son règne, les burundais bénéficieront d’une certaine accalmie car il n’y aura pas des tueries en masse comme celles qui avaient lieu en 1965 et 1972 avant lui ou celles qui auront lieu en 1988 et 1993 après lui.
Mais un tel embellissement ne manque pas de paradoxes. Il vient au pouvoir au moment où les plaies des burundais sont encore entrouvertes. La cassure ethnique est encore vive. Des centaines de milliers des burundais sont morts et d’autres ont fui leur patrie. Quand il se présente en ce moment précis de l’histoire entre Ikiza de 1972 et Ntega Marangara de 1988 après lui, il préfère promouvoir la politique du silence alors que les burundais ont à peine fait leur deuil. Personne n’est permis de parler de tutsi ou hutu. Il ne reconnait qu’une seule tribu, celle des Barundi. Car ni les Hutus, ni les Tutsis ne possèdent de langue, de culture, de religion qui leur soient propres, martelait-il. Il rejette les théories des ethnologues, distinguant une majorité hutu d'origine bantoue essentiellement vouée à l'agriculture, une minorité tutsi d'origine hamitique, éleveurs conquérants venus du Nord, et un groupe résiduel twa autochtone. Pour lui ces théories sont erronées et ont été reprises par des gens de mauvaise foi à des fins exclusivement politiques. Monarque éclairé ou subtil ? Ignorons les mots et observons les faits. Que ce qui se passe réellement et pratiquement sous son règne ?
Il introduit le système I et U pour discriminer les hutus dans l’éducation. (Le système a été baptisé « i » et « u » parce que devant le nom d’un écolier hutu, on marquait la voyelle u et i devant celui d’un tutsi afin d’empêcher aux hutus d’accéder à l’école secondaire.) Extérieurement, il a tout l’air d’un modéré sur les questions ethniques et décrète ainsi une amnistie pour tous les exilés hutus et libère un certain nombre de prisonniers politiques. Mais en pratique trop peu de choses sont faites pour que les réfugiés puissent récupérer leurs terres. Le favoritisme ethnique et régionale est bel et bien une réalité criante sous son règne malgré toutes les apparences.
Il ne suffit pas de comprendre juste intellectuellement que Les Hutus et les Tutsis du Burundi ne constituent pas une ethnie au sens anthropologique du terme. Bagaza a dû faire face, comme nous tous d’ailleurs, à la contradiction complexe de vivre dans un pays où on ne peut pas scientifiquement prouver qu’il existe des ethnies mais où la conscience ethnique Hutu et Tutsi est une réalité incontournable peu importe le cocktail de mensonges savants qui l’aurait façonnée. Missionnaires et colonisateurs avaient réussi à remplacer la conscience clanique, un clan qui pouvait se retrouver dans toutes les catégories par une conscience ethnique fabriquée à partir des catégories sociales et professionnelles. Je ne le dirai pas plus éloquemment que Melchior Mukuri, dans le rôle de l’Église catholique et de l’État dans la fabrication d’une identité dans le Burundi colonial.
On peut remercier Dieu qu’il n’y ait pas eu de bain de sang à l’échelle nationale sous son règne et qu’il était plus responsable que Micombero sur un bon nombre d’aspects. Mais aujourd’hui encore quelques burundais qui ont vécu la décennie du règne de Bagaza racontent encore les violences de sa police et de ses services secrets, un règne de terreur de son armée, des mesures d’intimidation permanente contre tout ce qui pouvait faire entrave à la suprématie Hima, que ce soit les restes de la dynastie ganwa, les membres de la famille royale, les soulèvements de la masse hutu ou des intrigues des batutsi banyaruguru.
BAGAZA s’acharne contre l’Église catholique(1)
Ce que j’ai écrit ci haut peut alors servir de prélude à la compréhension du conflit entre le président Bagaza et l’Église catholique, un conflit, qui par extension et indirectement va affecter les églises protestantes.
Pour bien asseoir son empire, Bagaza doit se confronter à une puissance : l’Église catholique. Elle représente une vraie menace pour lui. Il faut l’admettre, l’Église catholique est vraiment puissante en ce moment. Elle avait acquis une grande influence dans l’enseignement par sa campagne d’alphabétisation et ses écoles excellentes, une presse efficace, des vastes terres, des comptes bien remplis, une influence sur les masses. Elle constituait une puissance rivale potentielle. Juste une année après son accession au pouvoir, Il commença à combattre l’Église catholique. Aujourd’hui, beaucoup pensent qu’il s’agissait d’un véritable coup de suicide et que cette folie a bien précipité sa chute.
Mais Bagaza ne faisait pas que convoiter le pouvoir de l’Église. Son vrai problème était la catégorie de gens que ce pouvoir protégeait : les Hutus. Ces derniers avaient subi une marginalisation extrême dans la gestion politique et administrative du pays depuis la restructuration coloniale qui eut lieu entre 1925-1931. Les massacres sanglants de 1965 et 1972 avaient déplorablement décimé des familles tutsis mais tout cela n’était rien à côté de plus de 300.000 hutus tués et de plusieurs milliers exilés. Ces malheurs avaient renforcé la position pro-Hutu de l’Église catholique. Progressivement l’Église catholique commença à fournir un cadre d’expression pour les hutus qui réfléchissent et s’organisent sous le coaching des autorités catholiques. Cela, notre cher colonel ne pouvait le tolérer. Il accusa alors les autorités catholiques de ruiner ses efforts de réconciliation nationale, que l’église catholique perturbe l’ordre et l’unité nationale, tantôt ils sont accusés de subversion et d’être au service des étrangers, ennemis du pays. La guerre est ouverte contre Vatican, une guerre qui va sceller le destin du jeune colonel.
Les mesures anticléricales du colonel Bagaza
À peine arrivé au pouvoir, Bagaza mit en œuvre des mesures qui ont considérablement restreint les droits de l'Église, notamment la liquidation de la presse et de l'éducation catholiques en 1977. Toutes les écoles primaires catholiques furent étatisées. La tension entre l’Église et l’État atteignit un sommet lors du non renouvellement des visas de 200 missionnaires étrangers et de l’expulsion de 70 autres en 1979. Puis en 1980, il a fermé des églises et restreint les activités religieuses, celles de l'Église catholique et des missions protestantes. En 1985 la crise s’accentua lorsque quelques prêtres furent arrêtés. En 1986 le séminaire fut nationalisé et la catéchèse interdite aux laïcs. Bagaza alla jusqu’ à affirmer peu avant sa chute que l’Église « serait supprimée si elle continuait sa campagne ».
Pendant sa politique dit de laïcisation, on peut citer en passant ces reformes strictes qui ont touché l’Église catholique, mais aussi les églises protestantes.
Les Églises protestantes fermées dans la foulée
Dans cette lutte politique où les institutions religieuses locales sont soumises à un contrôle strict de l’État, Bagaza voulait fonder un État sécularisé dans lequel la religion ne devait jouer aucun rôle ou tout au plus un rôle subalterne. Les églises protestantes ne pouvaient pas échapper bien que sa cible principale fût l’Église catholique.
Les médias protestants ont été pris pour cible. Par exemple, la radio CORDAC était fermé aussitôt qu’en 1977. Quand sa campagne atteignit le point culminant, en 1984, le régime Bagaza expulsa tous les missionnaires, catholiques ou protestants, ferma des écoles et des dispensaires des missions, catholiques ou protestantes. Les infrastructures gérées par l’Église (écoles, dispensaires, programmes pour la jeunesse) ont été fortement réduites, voire démantelées. Selon certaines sources, plus de 400 églises et édifices religieux (dont des missions) ont été fermés ou saisis et l’Église protestante en souffrit également
Libéralisation et démocratisation sous le régime de Buyoya
On est le 3 septembre 1987, et le major Pierre Buyoya a destitué le colonel Bagaza. Aussi tôt au pouvoir, il se hâte de renverser les mesures anti religieuses de son prédécesseur, et restaurer la liberté religieuse. En 1988 il laisse les missionnaires retourner au Burundi.
Il établit de nouvelles mesures allant dans le sens d’une libéralisation de la vie des communautés religieuses. Il va permettre la réouverture des églises fermées y compris l’agreement de nouvelles qui ne soient pas missionnaires. C’est la naissance des églises indépendantes, localement fondées et n’ayant aucun lien avec les missions occidentales. On estime qu’entre 1988 et 1992, presque entre 70 et 100 églises indépendantes sont agréées par le ministère de l’intérieur. Sous les mandats de Buyoya, celui de 1987-1993, et celui de 1996-2003, le Burundi va connaitre une prolifération des églises, jamais enregistrée dans l’histoire du pays. Ce sont surtout des églises dites évangéliques, charismatiques ou des églises de réveil.
Après lui, le gouvernement born again de Nkurunziza cherchera à mettre en place des réglementations pour surveiller ou contrôler les nouvelles organisations religieuses devenues trop nombreuses. Sous Edouard Nduwimana, en tant que ministre de l’intérieur, on réalise que seulement entre 1993 et 2013 donc en une vingtaine d’années, le nombre des dénominations est passé de 45 à 557. Ceci a engendré l’adoption du projet de loi visant à lutter contre la prolifération des Églises nouvelles en 2014
Les Églises de réveil et leur apport
Cette phase de la prolifération des églises sous le régime Buyoya coïncide avec les vents du mouvement charismatique dans le monde. Si l’histoire du pentecôtisme classique dans le monde nous a donné l’Église pentecôte grâce aux missionnaires suédois, le christianisme va connaitre une autre exposition charismatique dans les années 80 et 90 ce qui va avoir des retombées sur la naissance des églises dites de réveil ayant presque toutes le même ethos charismatique. Alors que les églises missionnaires commençaient à perdre leur première ferveur spirituelle, on peut dire que les nouvelles églises cherchaient à raviver la foi chrétienne.
Les églises missionnaires sont quant à elles renfermées sur elles-mêmes. La plupart de ses membres sont nés dans des familles chrétiennes et n’ont jamais personnellement connue le Seigneur. Ils sont alors attirés par la foi dynamique dans les nouvelles églises et certains se joignent au mouvement. Ce mouvement est fait des églises qui tendent à être tournées vers l'extérieur par le témoignage qui défie au lieu d’être tournées vers l’intérieur où règnent formalisme religieux, conflits de leadership et luttes internes. On peut donner deux exemples des églises citadines qui ont eu le plus d’influence, Église vivante et Église du Bon Berger, toutes commencées par anciens leaders dans l’Église Anglicane.
Dans un contexte où les guerres avaient laissé des plaies profondes, ces nouvelles églises prêchaient l’amour, la réconciliation, la tolérance et mettaient l'accent sur la transformation personnelle, la repentance et la restauration émotionnelle comme le pardon. On rencontrait moins de cristallisations ethniques dans ces églises que dans celles qui sont missionnaires. Je donne un exemple typique. Les églises pentecôtistes et anglicanes étaient connues pour privilégier l’ascension des tutsis au leadership, alors que les églises baptistes, méthodistes ou les Amis privilégiaient un leadership hutu. En contraste les nouvelles églises comme Église vivante ou Église du Bon Berger ont eu un effet rassembleur pendant la crise. On pourrait évoquer les marches pour la paix organisées par David Ndaruhuste en pleine crise civile de Bujumbura alors que les quartiers s’étaient regroupés selon les ethnies.
Le mauvais côté du mouvement des églises de réveil
Je ne citerai que deux des plus importants. La grande liberté par laquelle, les nouvelles églises étaient agréées, a fait que des prétendus serviteurs de Dieu débutent des églises pour des fins personnelles égoïstes et manipulatrices, ce qui a largement contribué à la mauvaise réputation des églises protestantes en général. La loi nouvelle loi sur les églises et confessions religieuses que certains trouvent actuellement contraignante n’est que la conséquence d’un mauvais usage de la porte que Dieu nous avait ouverte pendant les deux mandats du major Pierre Buyoya.
Il y a eu prolifération des sectes et de faux enseignements, d’un côté lié aux dérives habituelles du mouvement charismatique mais d’un autre côté, lié au manque d’éducation, et instruction des leaders de ces mouvements, églises ou ministères. David Ndaruhutse tenta d’y remédier en invitant un couple missionnaire français pour remplir ce vide. Leur école, Institut Biblique Héritage, était censée éduquer les serviteurs de Dieu burundais tout en les aidant à maintenir le feu du Saint Esprit. Mais ce couple avait été lui-même éduqué aux États unis, dans l’une des écoles du fameux Kenneth Haggin, le père du mouvement de la prospérité dans le monde. Ainsi leur école, IBH, et plus tard leur Église El Shaddai, débutée vers la fin des années 90, devint le berceau du faux Évangile de la prospérité, Parole de Foi et Confession positive.
****
(1) LES SOURCES

NIKIZA Jean-Apôtre est né de nouveau en 1997 et appelé au ministère en 2005. Il est pasteur, enseignant, conférencier et écrivain. Il est fondateur du blog Sa Bannière depuis 2018, du mouvement biblique Green Pastures depuis 2015 et co-fondateur de Little Flock Ministries. Il est passionné par la spiritualité chrétienne et le renouveau de l’Eglise. Marié à Arielle Trésor NIKIZA, ensemble ils sont pionniers du mouvement des Hédonistes chrétiens au Burundi. Ils ont deux enfants : NIKIZA Thaïs Garden et REMESHA Nik-Deuel Trésor. NIKIZA Jean-Apôtre est aussi connu pour être un lecteur assidu des livres. Les grandes influences qui ont façonné sa vie et le ministère sont: Martyn Lloyd Jones, John Piper et A.W Tozer. Ses passe-temps sont : la musique, le basketball, les films et un bon sommeil.
CHOIX DE L'ÉDITEUR
L’adoration dans nos cultes
Si un mouvement ne chante pas, il meurt.
Le plus beau rêve ou le pire cauchemar ?
C’était en 2015, je venais de me réveiller en sursaut à trois heures du matin après un horrible rêve ! Je rêvais qu’un de mes êtres les plus chers était en procès et que la sentence était tombée … Il allait être exécuté.
Qui était David Ndaruhutse ?
Qui était David NDARUHUTSE? Quelles étaient ses origines ? Quelles ont été ses accomplissements durant sa courte durée dans le ministère ? Que sont devenus sa famille et son ministère ? Son Fils Peter NDARUHUTSE nous raconte.
La gloire de Dieu est mon trésor
Les saintes écritures nous exposent du début à la fin un Dieu, qui, dans Sa parfaite intelligence et selon le conseil de Sa parfaite volonté, bénit toute la création à partir de Sa gloire. Il a fait de sorte que toute joie réelle et durable passe par Sa gloire.
Quand lire la Bible devient une dure corvée
Soyons honnêtes, il nous est tous déjà arrivés de trouver la Bible ennuyeuse, au moins certaines de ses parties. Il nous est déjà arrivés de nous demander à quoi certains passages riment vraiment et pourquoi ont-ils été insérés dans un livre saint dont la lecture est sensée nous apporter tant d’excitation et de passion !